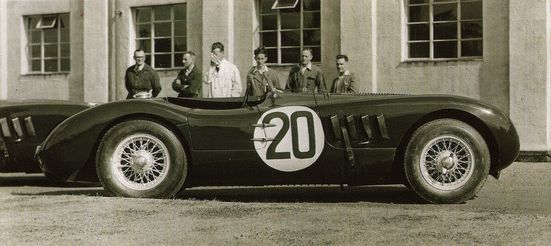
|
Type
C immortelles victoires | |
Encouragée par la démonstration de quelques roadsters XK 120 modifiés au Mans en 1950, Jaguar lança un assaut total en 1951 avec la XK120C, C pour compétition. Cette voiture conservait beaucoup de pièce de série, mais le sixcylindres 3.4 litres double arbre de production fut porté à 204 ch, tandis que la voiture recevait un châssis en treillis tubulaire, de nouvelles suspensions et une nouvelle carosserie aérodynamique entièrement redessinée. Appelée Type C, elle remporta sapremière course, inaugurant la série de cinq succès légendaires signés par Jaguar dans la grande classique française.
Pourquoi
les Jaguar sont-elles tant aimées ? Parce que, selon la légende,
William Lyons, un soir d'été en France, avait dit « oui ».
En
réalité, on peut supposer qu'il fit un commentaire favorable, du
genre : « Bien, alors allons-y carrément! » Il faut savoir
que son instinct sportif britannique était porté au paroxysme :
il venait de passer vingt-quatre heures à observer un trio de ses nouvelles
XK 120 roadster « Super Sports » engagées dans le « Grand
Prix d'endurance », la plus grande épreuve du monde pour voitures
de sport. C'était pratiquement des voitures de série auxquelles
on avait apporté un minimum de modifications en vue de la course et tout
le programme n'avait été qu'une prise de contact. Or, deux voitures
avaient terminé. Résultat honorable et encourageant. L'une d'elles
avait même démontré qu'elle avait le potentiel pour gagner.
C'était excitant, et suffisamment excitant pour autoriser quelque chose
d'aussi peu nécessaire que grandiose : un vraie tentative en vue de la
victoire absolue l'année suivante.
Dans des circonstances normales,
Lyons était méfiant, vis-à-vis d'une participation officielle
de sa firme à des courses. Il y voyait plus à perdre qu'à
gagner. Jaguar Cars Ltd marchait bien, créait sa clientèle et engrangeait
des bénéfices. La XK 120 avait recueilli davantage de commandes
qu'on ne pouvait en livrer avant longtemps. La production en grande série
de la version en acier venait de démarrer et l'impatience des clients en
attente commençait à se calmer. Mais la voiture n'avait guère
besoin de promotion.
Ni, d'ailleurs, Jaguar. La réputation de la-marque
était alors bien établie. Une belle berline moderne allait être
lancée, la Mark VII, dotée du même magnifique moteur que la
voiture sport tant désirée. Elle ne pouvait que rencontrer le succès.
Non, les arguments ne manquaient pas contre le fait de dépenser de l'argent
et du temps pour risquer un échec public dans une aventure aussi aléatoire
qu'une épreuve d'endurance. Heureusement, William Lyons n'avait pas besoin
d'en référer à un conseil hostile. Jaguar était à
lui. Il pouvait lui faire faire tout ce qui lui plaisait.
Courir au Mans ne
pouvait que satisfaire la plupart des membres de son équipe dirigeante.
Comme Lyons luimême, beaucoup étaient des fanatiques de sport automobile
et possédaient une certaine expérience de la chose. Son ingénieur
en chef, William Heynes, était pour la course et participait à l'occasion
à des compétitions. Frank « Lofty » England, directeur
de l'après-vente et chef du service course, avait un passé sérieux
dans le domaine sportif. D'une certaine manière discrète, précautionneuse,
scientifique, Jaguar Cars Ltd était une sorte de pépinière
du sport automobile.
Mais les ambitions restèrent soumises au jugement.
Lyons fut d'accord pour participer dès qu'il comprit que sa firme avait
quelque chance de gagner. Chaque étape, parcourue avec enthousiasme, était
pourtant soutenue -par une méthodologie pleine de logique.
Lorsque Lyons
convia le monde à admirer une XK 120 roulant à 212,3 km/h à
Jabbeke, en mai 1949, ses collaborateurs avaient pris bien soin, en privé,
de s'assurer que la chose était possible. De même, avant qu'une voiture
identique et deux de ses sueurs fussent engagées pour la première
épreuve sur circuit, en août, Lyons lui-même prit part aux
essais préliminaires. Lorsque la voiture de Jabbeke gagna à Silverstone,
ce ne fut pas une vraie surprise.
La performance du Mans, au mois de juin suivant,
fut plus surprenante. A ce moment-là, la XK 120 avait commencé à
se montrer non seulement rapide mais aussi fiable. Et les trois voitures engagées
dans les 24 Heures furent préparées avec soin et raison. Aucun essai
de tirer davantage de puissance des moteurs ne fut entrepris et l'on ne changea
pas ce qui avait bien fonctionné par ailleurs.
Les pare-chocs furent
démontés et les voitures reçurent les petits saute-vent et
les sièges-baquets enveloppants proposés dans le catalogue des accessoires.
Mais toutes coururent sans le carénage inférieur utilisé
à Jabbeke et leur aérodynamique fut encore détériorée
par le montage de phares auxiliaires. Pour éliminer le risque réel
de voir le long capot articulé à l'arrière s'ouvrir brutalement
en vitesse, les mécaniciens ajoutèrent de petites courroies de cuir.
Des bouchons à ouverture rapide furent fixés sur des réservoirs
de 110 litres remplaçant les réservoirs standard de 63 litres. Comme
ceux-ci prenaient la plus grande partie du coffre, les pièces de rechange
et l'outillage furent placés dans le seul espace resté libre, la
place du passager.
La plus grande différence avec le modèle de
série concernait le refroidissement des freins qui devait être amélioré
pour éviter l'évanouissement au bout des longues lignes droites
du Mans. Au lieu de monter des tambours Alfin disponibles en accessoires mais
qui pouvaient, selon Jaguar, se fêler sur des freinages aussi durs, l'équipe
choisit d'essayer d'augmenter le débit d'air sur les freins en plaçant
des disques munis de petites ailettes entre le tambour en fonte et le voile de
roue. Pour faire bonne mesure, ils percèrent des trous dans les tambours
eux-mêmes.
Les trois voitures prirent un bon départ, se mêlant
un certain temps aux voitures de tête. A la fin de la première heure,
la 120 blanche pilotée par Leslie Johnson conservait la cinquième
place. Comme son copilote, Bert Hadley, il continua d'appuyer toute la nuit et
se retrouva en seconde position à midi le lendemain. A ce moment-là,
ils tournaient à une moyenne qui les aurait mis dans les roues de la Talbot
4,5 litres, dérivée d'une voiture de Grand Prix. Cependant, préoccupés
d'économiser les freins, toujours sujets au fading malgré les modifications,
ils soumettaient la boîte de vitesses à des rétrogradages
assez brutaux. A trois heures de l'arrivée, le moyeu du disque d'embrayage
lâcha. Le roadster de Johnson vint échouer au bord de la piste en
vue des stands. Les deux autres voitures conduites avec davantage de ménagements
et exemptes de problèmes poursuivirent leur ronde pour terminer douzième
et quinzième.
Il est peu probable que l'équipe Talbot se serait
laissée battre par la Jaguar sur la ligne mais, pour les hommes de Coventry,
il était évident que leur voiture possédait le muscle et
le coeur nécessaires pour vaincre. Si ce qui n'était, après
tout, qu'une sportive de tous les jours pouvait tourner à 156 de moyenne,
soit 8 km/h de moins que le meilleur tour de la Talbot, voiture de Grand Prix
dotée d'ailes et de phares, imaginons ce que le puissant moteur XK pouvait
donner dans un vrai châssis de course. Heynes a très bien pu glisser
au patron, pendant la course, quelques croquis et quelques calculs d'estimation.
Toujours est-il que, dans l'euphorie qui suivit l'arrivée, ce fut «
oui ».
Le processus qui devait conduire à la XK 120C 1951 ne commença
pas immédiatement. En premier, la berline Mark VII devait être terminée,
lancée et mise en production. Il y avait aussi un certain nombre de sportifs
qui faisaient courir sur circuit ou en rallye des XK 120 et qu'il fallait continuer
à soutenir. A l'automne, Heynes et sa bande se mirent enfin à la
tâche enthousiasmante de concevoir leur « type Le Mans ». .
Les
voitures, plus exactement. Conscient alors de l'ampleur du programme qu'il avait
agréé, Lyons mit en route parallèlement un autre plan moins
ambitieux. Dans l'hypothèse où les types « course »
ne seraient pas prêts à temps, il y aurait un trio de voitures ressemblant
davantage aux XK 120, mais avec des cadres de châssis allégés
et des caisses en magnésium assemblées à la main. Ces carrosseries
dites LT furent construites mais ne furent jamais utilisées au Mans. Elles
finirent sur des châssis standard vendus à des privés.
Le
principe à la base des vraies voitures de compétition consistait
à « rhabiller » le plus possible de composants mécaniques
XK 120 sous une carrosserie plus petite, plus légère et plus aérodynamique.
Mais la voiture ne devrait pas être un simple « hot rod ». Ce
serait le résultat d'une application rigoureuse de principes scientifiques.
L'équipe
commença, comme tout le monde, par des croquis griffonnés. L'un
d'eux, peut-être dû à Heynes luimême, a été
publié par Philip Porter dans Jaguar: History of a Classic Marque. Il montre
clairement les éléments essentiels de la voiture définitive
: empattement réduit de 15 cm (à 2 438 mm), réservoir de
180 litres monté au-dessus du pont arrière et dans l'arrière,
et roue de secours disposée sous l'extension du réservoir. Le pilote
était placé juste devant les roues arrière et logé
entre elles et le moteur, luimême reculé en arrière de l'axe
de l'essieu avant.
Après une série de modèles de visualisation
en papier et en bois (même des manches à balais, dit Heynes plus
tard), et beaucoup de calculs fastidieux (l'ordinateur n'existait pas), le «
racer » prit forme avec une logique non dénuée d'esthétique.
Comme prévu, un grand nombre de pièces de série furent conservées
mais il fallut néanmoins fabriquer beaucoup de pièces spéciales.
Le châssis était un treillis de tubes d'acier entre 25,4 et 51 mm
de diamètre soudés de manière à former une structure
spatiale rigide et légère. L'incorporation de panneaux en tôle
d'acier dans le tablier pare-feu et le tablier arrière apporta un supplément
de résistance à ces châssis virtuellement monocoques.
La
structure principale s'arrêtait juste derrière l'habitacle et l'axe
arrière était suspendu à la suite sur des bras tirés.
Ces bras étaient attachés par leur extrémité avant
à l'élément élastique sous la forme d'une unique barre
de torsion transversale fixée en son centre de manière à
former deux demi-barres séparées. Les avantages de cette formule
se traduisaient par un gain de poids, un meilleur guidage du pont et l'élimination
des frictions interlames qui introduisaient un amortissement aléatoire
constaté sur les XK 120 normales à ressorts semi-elliptiques. Les
amortisseurs à bras de celles-ci avaient fait place à des appareils
télescopiques. .
Une autre innovation intéressante apparut à
l'arrière. Afin de réduire le patinage en l'absence de différentiel
à glissement limité, Jaguar conçut une biellette de réaction
montée au-dessus du pont côté droit et dirigée vers
l'avant. Normalement, avec un pont classique, le pignon a tendance à «
monter » sur la couronne, créant une force verticale qui tend à
alléger la roue arrière droite et à la mettre en patinage
au moment même où le couple moteur est maximal. C'est pourquoi les
voitures puissantes dotées de ce type de pont sans différentiel
à glissement limité laissent une grosse traînée de
gomme au démarrage. La nouvelle liaison de Jaguar était positionnée
et orientée de manière à absorber cette force de cabrage
et à appuyer davantage la roue droite sur le sol. Naturellement, elle guidait
aussi le pont en direction et réduisait la tendance au braquage induit
et aux saccades en accélération. Initialement, cette liaison était
un triangle ayant aussi pour fonction de guider le pont contre les forcs latérales.
A 1 295 mm, la voie arrière était plus large de 25 mm par rapport
à la voiture de série.
A l'avant, les bras de guidage, les barres
de torsion et la barre antiroulis transversale étaient similaires aux éléments
de la XK 120 mais la géométrie était un peu différente.
La voie, 1 295 mm, était la même. La direction avait été
revue, une crémaillère remplaçant le boîtier à
recirculation
de
billes de la voiture de série de manière à mieux «
sentir » la route mais aussi à obtenir une démultiplication
inférieure donc une meilleure réponse.
Les freins étaient
toujours à quatre tambours en fonte mais, à l'avant, un système
de réglage automatique à rattrapage d'usure éliminait l'allongement
de la course à la pédale qui apparaissait sur les premières
XK 120 après des freinages puissants et répétés. Les
roues étaient à rayons fils et serrage central et de 16 pouces de
diamètre comme sur les voitures de série, mais les jantes avaient
un pouce de plus (25,4 mm) pour arriver à six pouces de largeur. Elles
étaient en aluminium et chaussées de pneus Dunlop « racing
».
La carrosserie était une toute nouvelle forme enveloppante,
basse et arrondie, conçue pour une bonne pénétration dans
l'air, du moins comme on l'entendait à l'époque. En fait, la forme
était due à un aérodynamicien aéronautique professionnel,
Malcolm Sayer. La Type C fut donc l'une des rares Jaguar non dessinées
par Lyons. La raison, comme l'avoua plaisamment Bill Heynes plus tard, en était
que le patron était en voyage d'affaires aux Etats-Unis à cette
période critique ...et que le travail fut ainsi réalisé en
un temps record
La carrosserie était spéciale aussi sur d'autres
points. Une seule porte côté droit répondait au règlement
et tout l'ensemble capot-face avant pivotait d'arrière en avant pour dégager
au maximum la mécanique. Un siège passager était prévu
mais il s'agissait d'une affaire symbolique, inconfortable et perchée sur
le coffre à outils. Pour s'y asseoir, il fallait enjamber la fragile carrosserie
en aluminium sans porte de ce côté-là. Il n'y avait pas de
coffre à bagages mais une trappe d'accès très basse pour
la roue de secours.
Contrairement à l'année précédente,
le six cylindres XK avait été « travaillé » en
prévision de la saison 1951. Les orifices d'échappement agrandis
avaient imité les soupapes, et les arbres à cames présentaient
une levée supplémentaire de 1,58 mm (totale de 9,52 mm). De nouveaux
ressorts de soupapes avaient reculé le régime d'affolement à
6 500 tr/mn, soit 1 000 tours de plus que le régime de couple maximal.
De nouveaux pistons à jupe intégrale donnaient un rapport volumétrique
de 9 à 1, mais les deux carburateurs étaient toujours les SU de
série de 1,75 pouce de diamètre. L'air était conduit aux
carburateurs à partir de l'avant comme sur les 120 de série, mais
sans filtre. Le collecteur d'échappement était toujours coulé
en fonte mais d'une dimension supérieure, compte tenu de l'augmentation
de régime. Les coussinets de ligne d'arbre étaient renforcés
et l'amortisseur de vibrations de vilebrequin était modifié. Naturellement,
le volant moteur avait été allégé. L'allumeur et la
courbe d'avance avaient été adaptés. A 5 500 tr/mn, le moteur
de course délivrait 204 ch.
Tirant les leçons de la panne de
Johnson/Hadley en 1950, les ingénieurs de Jaguar installèrent un
embrayage à disque renforcé sans ressorts amortisseurs. En même
temps, ils optèrent pour un nouvel arbre de transmission facilitant la
dépose en vue de changer le couple conique. Ce même souci les conduisit
à remplacer le pont ENV des XK de série par un Salisbury qui offrait
un plus grand choix de rapports.
Comment désigner cette voiture ? Un
moment, apparemment, on pensa à « XK 150 » en fonction de la
vitesse maximale estimée. A la fin, et en dépit des nombreuses différences
par rapport aux XK 120 de série (dont certaines seraient adoptées
en production sur le principe « la course améliore la race »),
on se référait toujours à la XK 120, mais en version «
compétition » : XK 120C. Cet élément ajouté
aux numéros de châssis commençant par le préfixe XKC
imposa la désignation Type C qui resta.
Prête à courir,
la XK 120C était était bien plus légère que ses soeurs
de route, au poids de 958 kg environ, d'après les chiffres publiés
par l'ingénieur de Jaguar Robert
|
L'ensemble capot
face avant se relevait d'un bloc pour dégager la mécanique, et la
petite porte à droite était le seul moyen d'accéder à
bord (page de gauche). A gauche : la Type C n° 20 dans les esses du Tertre
Rouge va gagner les 24 Heures du Mans en 1951. Des ruptures de canalisations d'huile
éliminèrent les deux autres Type C. Peter Walker et Peter Whitehead
établirent un nouveau record avec cette voiture. |
Berry
dans le livre Jaguar : Motor Racing and the Manufacturer. Le gain était
d'environ 30 pour cent, mais alors que les routières étaient légèrement
plus chargées à l'arrière, le type course présentait
une répartition des masses de 51,5 pour cent à l'avant et de 48,5
pour cent à l'arrière. Son maître couple était légèrement
inférieur à celui de la XK 120 équipée de saute-vent,
mais le profilage réclamait 22 pour cent de puissance en moins pour maintenir
la même vitesse. Lors d'essais répétés, la Type C atteignit
231,7 km/h.
Les trois voitures du Mans furent achevées seulement six
semaines environ avant la course. Ce délai suffit à Stirling Moss
et à Jack Fairman pour procéder aux essais. Ils ne signalèrent
que peu de modifications : pour ses débuts en compétition, Jaguar
avait bien travaillé.
Si bien travaillé que la Type C gagna sa
première course, la course pour laquelle elle avait été créée,
la plus importante épreuve pour voitures de sport du monde, les 24 Heures
du Mans. Battant des Allard, Aston Martin, Cunningham, Ferrari, Nash-Healey et
Talbot, une Jaguar pilotée par Moss sortit du peloton pour prendre la tête
au troisième tour et par la suite battre le record du tour de 6 secondes
à la moyenne de 169,2 km/h. (Moss dit plus tard qu'il aurait pu tourner
à 172.) Les deux autres Type C marchèrent aussi bien et, à
la cinquième heure, l'équipe débutante tenait les trois premières
places.
C'est alors que deux moteurs rendirent l'âme, suite à
la rupture d'une canalisation d'huile. Très inquiet, le directeur de l'équipe
donna ordre de ralentir à la voiture survivante. Heureusement, l'opposition
avait aussi fondu et la Jaguar pilotée par Peter Walker et Peter Whitehead
put assurer la victoire à la moyenne de 150,4 km/h, battant Talbot de 107,8
km. C'était la première victoire britannique au Mans depuis le succès
de Lagonda en 1935.
Les Type C remportèrent deux autres victoires en
cette passionnante saison 1951. Moss en signa une en Irlande où il avait
déjà gagné en 1950 le Tourist Trophy avec une XK 120. Il
triompha encore sur le circuit anglais de Goodwood. Bilan : trois courses, trois
victoires pour la nouvelle jaguar.
Pour 1952, de grands projets furent lancés.
D'une part, une série de types C fut mise en construction à l'intention
des pilotes privés. D'autre part, en coulisse, jaguar entamait un long
et sérieux programme d'étude avec Dunlop et Girling en vue de mettre
au point des freins à disque.
Le frein à disque n'était
pas une idée absolument neuve, même à cette époque.
L'Anglais Frederick William Lanchester avait breveté un système
primitif destiné à sa voiture dès 1902 et beaucoup d'autres
avaient expérimenté différents procédés applicables
à la course et à la route au début des années 1940.
Girling et Dunlop furent parmi les pionniers, comme Lockheed, Goodyear, General
Motors et Ausco-Lambert aux Etats-Unis.
Les progrès accomplis après
la guerre, et dus en grande partie à de larges emprunts aux technologies
aéronautiques, incitèrent Chrysler à proposer le «
Safety Brake » Ausco-Lambert en option avec supplément sur les grosses
berlines Crown Imperial produites en petite série dès 1949. L'année
suivante, la petite firme Crosley, de Cincinnati, Ohio, proposa les freins Goodyear-Hawley
en option sur ses roadsters Hot Shot. Malheureusement, ce système, insuffisamment
essayé, se révéla sensible à la corrosion par le sel
des routes. Quelques Hot Shot de course reçurent des disques, mais il apparaît
que la première tentative sérieuse d'utilisation des disques en
compétition fut le fait d'Harry Miller sur sa voiture à quatre roues
motrices engagée à Indianapolis en 1940.
Le journaliste Jan Norbye,
dans une rétrospective écrite pour le journal Specia Interest Autos
en 1973, rappelle que le frein à disque moderne est né en Angleterre
après la guerre chez Dunlop : « Alors que Goodyear dérivait
son
frein
pour avion sur brevets Hawley...(Dunlop) créait son propre modèle
...qui, à son tour valut à Dunlop un certain nombre de brevets.
La particularité du frein à disque Dunlop était que le rotor
et l'étrier étaient, fixés dans le plan axial. Bien qu'il
fût inutilement coûteux selon les normes de production américaines,
il donna de bons résultats. Girling acheta la licence de fabrication pour
produire des freins à disque pour voitures de tourisme d'après les
brevets Dunlop, et le système prototype fut exposé au Salon de Londres
de 1951. »
Jaguar fut parmi les premiers constructeurs à essayer
les disques Girling qui paraissaient très prometteurs, au moins d'après
les souvenirs personnels de Norbye : « Je me rappelle avoir piloté
une Jaguar Mark VII équipée de freins à disque expérimentaux
Girling en 1952 à Goodwood. C'était impressionnant de freiner la
grosse berline de 175 km h à l'arrêt sur 90 m environ avec un équilibre
latéral parfait. » C'était apparemment sur le sec. Sur le
mouillé, Norbye aurait sûrement jugé le comportement du système
supérieur au meilleur des freins à tambour. Il présentait
une résistance au fading supérieure, une efficacité particulière
sur le mouillé et les disques semblaient très avantageux en course.
Jaguar voulut utiliser cet atout pour Le Mans en 1952 mais, les essais n'étant
pas terminés, ces freins ne furent pas montés.
En revanche, un
nouveau moteur apparut. La compression avait été réduite
à 8,5 à 1 pour tenir compte de la mauvaise qualité de l'essence
fournie par les organisateurs et la courbe de couple fut relevée grâce
à deux carburateurs de 2 pouces de diamètre. Le résultat
se traduisit par de meilleures accélérations et la perte d'un seul
cheval au régime de puissance maximale. Mais, au dernier moment, la firme
prit la décision de courir avec une carrosserie complètement r.;
. elle. Et ce fut le désastre.
L'idée, en soi, était bonne
: gagner en vitesse de pointe. Le motif ? Une concurrence nouvelle. L'instigateur
fut Stirling Moss, de retour des Mille Miglia en Italie (où il avait d'ailleurs
testé en course les freins à disque), qui raconta comment son type
C avait été battu par le nouveau coupé Mercedes-Benz 300SL,
une voiture qui allait aussi courir au Mans. Moss plaida sa cause avec tant d'insistance
qu'on n'alla pas plus loin dans la motivation. On dessina donc et on construisit
de nouvelles carrosseries aérodynamiques et le trio de voitures fut envoyé
en France sans essais sérieux préalables ni soutien sous la forme
des voitures de l'année précédente.
II restait suffisamment
de temps pour les essais et les nouvelles Jaguar à nez plongeant se révélèrent
plus rapides sur les Hunaudières de quelque 16 km/h à environ 246
km/h en pointe. Mais deux problèmes apparurent.
L'un concernait le nouveau
profil. Bas et arrondi à l'avant, abaissé et pointu à l'arrière,
il ressemblait non seulement à une aile d'avion (en coupe) mais en avait
le comportement. Les voitures avaient tendance à décoller. L'arrière
se soulevait au point que l'appui des roues au sol était amputé
d'environ 25 pour cent : les pilotes revenaient au stand pâles d'angoisse
en indiquant que la voiture présentait une instabilité dangereuse.
Déjà, l'ancienne caisse avait montré une tendance au décollage
mais dans une moindre proportion.
L'autre problème était pire
et se résumait en un mot : surchauffe. Après quelques tours aux
essais, les trois voitures commencèrent à bouillir. Les dommages
résultants semblèrent même irréversibles, circonstance
aggravée par le manque de rechanges. Malgré la modification hâtive
de deux radiateurs juste avant la course, les trois voitures abandonnèrent
honteusement une heure seulement après le départ. William Lyons
vivait un vrai cauchemar.
Ironiquement, le nouveau coupé Mercedes confirma
sur la ligne droite des Hunaudières les craintes de Moss et gagna.
Mais
comme le montrèrent les essais ultérieurs, la surchauffe des nouvelles
Type C n'était pas causée directement par la forme aérodynamique
mais par une circulation d'eau insuffisante dans le nouveau circuit de refroidissement
hâtivement conçu en fonction du nez plongeant. Ce problème
fut rapidement résolu. A ce stade du savoir en matière aérodynamique,
et compte tenu des ressources limitées de la firme, l'instabilité
à grande vitesse semblait inhérente au dessin et incurable. II faudrait
encore dix ans avant que le pilote américain Richie Ginther, au cours d'essais
avec Ferrari, n'invente l'aileron arrière atténuant ces phénomènes
non contrôlables.
Jaguar n'abandonna pas ses rêves de carrosserie
à faible traînée après Le Mans 1952, mais elle liquida
le nez plongeant et revint à la carrosserie type C originale tout en jurant
bien de ne jamais plus s'engager en course sans une préparation sérieuse.
Plus tard dans l'année, Moss signa une première historique en gagnant
à Reims avec des freins à disque.
Cette saison 1952 vit d'autres
succès et d'autres échecs, mais tous assortis d'une leçon
à retenir. L'équipe Jaguar envisagea donc de revenir au Mans, pour
la quatrième fois, avec une précieuse expérience collective.
Les
Type C 1953 en représentèrent les fruits avec un gain de puissance
en plus. Un nouveau changement de carburateurs apporta trois double corps Weber
de 40 mm nourris en air non plus par l'avant mais par une écope sur le
capot. Cette solution, complétée par d'autres modifications, donna
environ 220 ch mais au régime plus confortable de 5 200 tr/mn. Ce gain
de puissance compensait la moitié de la différence de vitesse résultant
du retour à l'ancienne caisse et la voiture la plus rapide fut chronométrée
à près de 240 km/h. Mais le gain en couple aux régimes moyens
était des plus utiles en accélération. Parmi les améliorations
de détail, on notait un amortisseur de vilebrequin plus robuste, des segments
de pistons plus étanches, un embrayage compétition à trois
disques plus solide mais plus petit et une pompe à eau et un faisceau de
radiateur différents améliorant la circulation du liquide.
Si
les voitures de 1953 semblaient identiques aux Type C de 1951, elle étaient
allégées de plus de 20 kilos. Le gain de poids provenait d'une réduction
du diamètre de certains tubes du châssis et des épaisseurs
de tôles de carrosserie, et de certains détails comme le circuit
électrique. Même les câbles de batterie étaient en aluminium
comme sur les avions. Autre emprunt à l'aéronautique, les réservoirs
étaient des outres en caoutchouc, plus sûres et plus solides. Les
réservoirs en aluminium s'étaient parfois fendus en course.
Les
ruptures subies précédemment amenèrent à des modifications
de la suspension arrière où la biellette de réaction triangulaire
avait été remplacée par une barre simple du fait qu'elle
ne servait plus au guidage latéral. Cette fonction était dorénavant
confiée à une barre Panhard classique prise entre l'extrémité
droite du pont et une attache du côté gauche du châssis.
Enfin,
il y avait les freins à disque. Le programme de recherche et développement
avait été long et difficile et parfois intéressant lorsqu'un
essayeur se retrouvait sans frein à l'entrée d'une courbe. Mais
les problèmes initiaux, effort à la pédale, vibrations des
plaquettes (mauvais guidage dans l'étrier) avaient été résolus
et les freins à disque endurants, exempts de fading et renforcés
par l'action du servo jouèrent un rôle majeur dans la seconde victoire
de Jaguar au Mans.
Le combat fut encore plus dur que lors des éditions
précédentes, les Jaguar étant confrontées aux Alfa
Romeo, Allard, Aston Martin, Cunningham, Ferrari, Frazer-Nash, Gordini, Porsche
et Talbot. On attendait peu des Jaguar Type C à cause de leur médiocre
prestation de l'année précédente et d'une série de
défaillances récentes.
Le week-end débuta même par
une fausse note, les officiels refusant le départ à la quatrième
voiture, engagée sous le numéro d'une concurrente après avoir
été une voiture d'essai. L'infraction était grave et les
pilotes impliqués dans cette substitution pensèrent que leur voiture
serait disqualifiée. Tony Rolt et Duncan Hamilton, deux personnages hauts
en couleurs comme le sport automobile, surtout en Angleterre, en connaît,
filèrent en ville faire la fête pour oublier l'incident, persuadés
qu'ils ne courraient pas. Mais William Lyons transigea avec les organisateurs
en payant une amende et la voiture fut réadmise. Le seul problème
concernait les pilotes en bordée qui n'avaient guère songé
à dormir.
Vint le samedi après-midi. Moss doubla la monstrueuse
Ferrari 4,5 litres pour s'emparer du commandement au cinquième tour...
et rentrer au stand immédiatement sur panne d'alimentation. Rolt et Hamilton
marchant, eux, à l'adrénaline, prirent sa place. S'ensuivit une
bataille terrible qui dura des heures à des vitesses folles, au cours de
laquelle Hamilton percuta un oiseau qui pulvérisa la moitié de son
saute-vent avant de le blesser au nez et à la tête. Mais la voiture
et l'équipage de Coventry dominèrent sans défaillance une
concurrence coûteuse et variée. A 16 heures, le dimanche, Rolt/Hamilton
passèrent la ligne les premiers
suivis
par Moss/Walker, deuxièmes, et Whitehead/Ian Stewart, quatrièmes.
La moyenne avait été portée à 170,3 km/h, nouveau
record.
La journée avait été épique. Un deuxième
triomphe sur la terre sacrée pour les Anglais, où Bentley avait
signé cinq victoires, établit définitivement la mesure de
jaguar dans le domaine des voitures de sport. Et pour être sûr que
nul n'en ignore dans le monde, le département publicité de la firme,
toujours vigilant, eut la brillante idée d'envoyer un télégramme
à la jeune souveraine, la reine Elizabeth II, et s'arrangea pour que la
presse en eût connaissance. En voici le texte:
L'ÉQUIPE JAGUAR PRÉSENTE SES HOMMAGES TRÈS RESPECTUEUX A SA MAJESTÉ ET CROIT DEVOIR L'INFORMER QUE, POUR L'ANNÉE DE SON COURONNEMENT, ELLE VIENT DE REMPORTER POUR LA GRANDE-BRETAGNE LA PLUS GRANDE ÉPREUVE DU MONDE HIER AU MANS, EN FRANCE.
La destinataire eut la bonté de faire répondre par son secrétariat privé
LA REINE EST TRÈS HEUREUSE DE CE SUCCÈS DE L'ÉQUIPE JAGUAR. TRANSMETTEZ S'IL VOUS PLAÎT LES SINCÈRES REMERCIEMENTS DE SA MAJESTÉ A TOUS SES MEMBRES POUR LEUR AIMABLE ET LOYAL MESSAGE.
Mais si le Type C avait fini sa carrière comme voiture de compétition d'usine, il allait continuer pendant plusieurs années à briller aux mains de pilotes privés dans le monde entier. Cette voiture servit même de vraie « Super Sport » de route et, parmi ses utilisateurs, on note le grand champion d'Alfa Romeo, Giuseppe Farina.
dénuée
de caprices ». Les 800 kilomètres de randonnée en Europe,
accomplis sans ménagement constituaient « une mémorable et
grandiose expérience ». Ici, un soupir...
Monter à bord
d'une Jaguar XK 120C demande une certaine souplesse car la seule porte du côté
droit est petite et le treillis de tubes du châssis rehausse le seuil. Une
fois assis, l'espace est compté, notamment en longueur. Le volant à
trois branches en plastique de 17 pouces (43 cm) paraît large, vertical
et proche, comme la barre d'un bateau. Comme sur la voiture de série, il
peut être réglé en distance mais il faut un outil. Il n'y
a pas de place pour incliner le dossier du siège s'il était inclinable.
Les caves pour les pieds sont peu profondes si bien que les genoux semblent trop
pliés. Si la caisse est presque aussi haute que celle de la XK 120 de série,
on n'est pas assis sur une traverse et l'on a donc l'impression d'être très
enfoncé.
Dans le champ visuel, plus de métal que de garnitures.
Pour le vent et la pluie, on ne trouve qu'une paire de saute-vent rabattables
et, sur certaines voitures, un seul écran bas de plastique mince. Et c'est
tout : ni essuie-glace ni capote. Le chauffage? Le bloc de fonte sous le capot.
Et avec l'arrière occupé par le réservoir et la roue de secours,
le seul emplacement possible pour les bagages se situe sous les coudes.
Malgré
sa préparation en vue de la compétition, le gros six cylindres s'éveille
à la première sollicitation du démarreur et révèle
une étonnante aptitude au ralenti. Si l'on ne sollicite pas trop l'accélérateur
à froid, avec risque de coupure, il pousse avec presque autant de couple
et de docilité que le XK 120. Mais, tandis que le moteur de route continue
à pousser régulièrement sans marquer de creux, le Type C
se réveille une deuxième fois à 3 000 tr/mn. Il atteint alors
sa plénitude. Rauque et vigoureux, le son de l'échappement devient
musique pure et le compte-tours bondit vers la zone rouge avec une vivacité
étonnante.
Parfaitement complémentaires de la nature symphonique
du moteur, les courbes sculpturales de l'avant semblent s'élancer sur la
route. Conduire une Type C à grande vitesse est un spectacle en soi, pour
les yeux comme pour les oreilles, et si l'on est assis très bas, au point
de s'inquiéter de la position exacte d'un trottoir ou d'un bascôté,
la route libre ne pose aucun problème.
L'embrayage est léger
et progressif et sa longue course n'est pas gênante, mais le levier du sélecteur
à gauche surprend par son débattement et sa hauteur, et son déplacement
vers la position de marche arrière (à gauche et en avant) demande
un peu de pratique. En outre, lorsque la boîte a accumulé quelques
miles dans ses synchros, elle proteste lors des changements rapides en émettant
quelques râclements.
En revanche, la direction à crémaillère
est une pure merveille avec cette sensation de douceur, de légèreté
et de précision propre à toute automobile bien née. En contraste,
le comportement de la voiture sur la route semble un peu « vintage »
avec sa suspension sans concession bondissante sur les cahots. Grande voiture
en apparence, elle semble plus petite et agile dans la main, facile à placer
sur ses trajectoires. En virage particulièrement serré, il faut
un pied très léger pour empêcher les roues arrière
de décrocher au freinage et de patiner à l'accélération.
En courbe plus ouverte, la Type C se contrôle bien et suit bien sa trajectoire
pour une voiture de cette époque, mais son châssis aurait tendance
à vouloir décrire une série d'arcs secondaires dans les très
grandes courbes. Les pilotes qui surent tirer parti de la première machine
de course de Jaguar avaient appris à la mener avec autorité et fermeté.
Jaguar
fabriqua en tout 54 Type C. Quantité suffisante pour connaître l'immortalité.
Photos et texte extrait de "Jaguar, Toute l'Histoire, tous les Modèles" de Pete Lyons